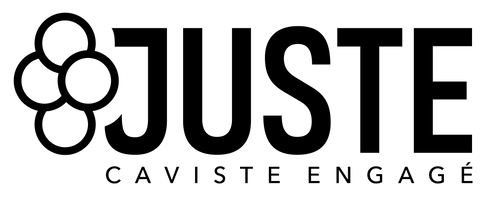On peut le dire, être vigneron c’est un métier complet. Et sans même évoquer la commercialisation voire le marketing ou la communication, c’est une profession qui exige des savoir-faire différents. On compte 3 étapes majeures dans la production d’un vin : la viticulture, la vinification et l’élevage. Allez on est parti pour un aperçu des trois.
Viticulture :
Pas de vin sans raisins donc première étape de l’élaboration d’un vin : la viticulture. Autrement dit la culture de la vigne avec l’objectif ultime de récolter les fruits les plus beaux et les plus sains possibles. Et ça ne se fait pas tout seul !
Mais attention, avant même de la cultiver, il faut planter la vigne ! L’affaire paraît toute bête, entendue, mais de la bonne manière de réaliser ce préalable, dépend en grande partie la capacité de la vigne à donner de beaux fruits dans le futur. Une fois le terrain préparé à l’accueil de la vigne, il faut opter pour le bon matériel végétal et la meilleure façon de l’implanter : tout est important, le choix du porte-greffe le mieux adapté (depuis la crise du phylloxéra, on plante des porte-greffe résistants au vilain puceron, puis on greffe dessus un plant du cépage choisi), l’origine du plant, la technique de greffage, etc. Ensuite ? Accompagner la croissance de la jeune vigne durant quelques années jusqu’à ce que ses fruits soient dignes d’être vendangés puis vinifiés.
« Tout se fait à la vigne », affirment les vignerons bio-biodynamique-nature… Traduction : impossible de faire de jolis vins sans une matière première prometteuse. Pour l’obtenir, le vigneron agit sur le sol et sur la plante. L’idée générale ? Avoir un sol vivant à l’activité microbienne riche dans lequel la vigne, via son système racinaire, va pouvoir aller chercher l’expression du terroir dans toute son originalité et sa complexité. Autant vous dire que la viticulture conventionnelle, avec son arsenal de produits chimiques, est très limitante de ce point de vue.
A propos de la gestion du sol, il n’existe pas de recettes car le vigneron agit en fonction de son contexte, de la géologie, du climat, de l’âge de ses vignes, de la pente et d’une foule d’autres critères. Au-delà du souci permanent de garder un sol vivant, sa gestion peut avoir différents objets : l’aération du sol, éviter les risques de tassement, limiter les risques d’érosion, apporter un peu d’engrais naturel, lutter au printemps contre une végétation qui peut faire trop concurrence à la vigne ou créer des foyers humides favorables au développement de maladies comme le mildiou, etc. Travailler le sol mais ne pas non plus le labourer en profondeur pour ne pas casser son fonctionnement et, en particulier, ne pas bouleverser le travail précieux des vers de terre qui, en creusant des galeries, l’aère et permettent aux racines de plonger en profondeur.
Toute l’année ou presque, le vigneron intervient aussi sur la plante. En hiver, c’est la taille ! Pendant que la vigne sommeille, il faut donc la tailler de manière à limiter le nombre de bourgeons sur chaque souche pour réguler la production de raisins : le vigneron prend alors en compte plein d’éléments, la physionomie du cep, la vigueur du cépage, les rendements envisagés, l’importance de ne pas créer trop de plaies sur le bois qui peuvent être autant d’entrées pour des parasites, la pérennité de la plante, etc. Au printemps, le vigneron est dehors ! Il peut pratiquer l’ébourgeonnage pour encore limiter le nombre de grappes sur chaque pied, traiter aussi ses vignes pour lutter contre le mildiou ou l’oïdium, remonter des fils du palissage pour « tenir » la plante qui pousse de manière spectaculaire, etc. Les vigneron(ne)s ont du pain sur la planche, passent beaucoup de temps dehors, et pas seulement pour le plaisir de la balade…
Vinification :
Une fois les raisins vendangés, direction le chai où la matière première, comme par magie - ou presque ( !) -, va devenir « vin ».
Les grandes étapes de la transformation des raisins en vin ?
-L’égrappage ou éraflage : on sépare la rafle des raisins pour ne garder que ces derniers. Mais certains vignerons zappent cette étape pour vinifier en grappes entières.
-Le foulage : sans en faire de la bouillie, on écrase les raisins pour en libérer le jus. Egrappage et foulage sont souvent opérés par une machine appelée « fouloir-égrappoir ».
-La macération : le moût (ou jus) de raisin et les matières solides (peau, pulpe, pépins) sont mis en cuve. Au contact des secondes qui contiennent les polyphénols (tannins, pigments…), le premier gagne en couleur et en structure. De quelques jours à deux ou trois semaines, cette phase appelée aussi cuvaison est obligatoire pour les rouges, courte ou absente pour les rosés, et elle n’existe pas pour les blancs, à l’exception des blancs dits « de macération ».
-La fermentation alcoolique : le cœur même de la vinification durant la macération. Grâce aux levures qui dévorent les sucres, le jus de raisin se transforme en vin !
-Le pressurage : il s’agit de presser dans le pressoir ! Pour les rouges, le pressurage intervient après la macération. Pour les blancs classiques, il est réalisé juste après l’arrivée de la vendange en cave, d’où l’expression « pressurage direct ».
Ces cinq étapes dessinent un cadre général… Mais, en fonction du type de vin – rouge, blanc, rosé, sec, doux, tranquilles ou avec bulles -, le « mode d’emploi » de la vinification diffère. Il peut aussi être très variable en fonction de la philosophie de chaque vigneron ou de chaque propriété : au-delà du style de vins souhaité - légers ou puissants par exemple -, certains pratiquent des vinifications très interventionnistes, très consommatrices d’intrants et de techniques œnologiques, quand d’autres, les « nature » notamment, revendiquent au contraire un non interventionnisme, juste un accompagnement rigoureux du vin qui doit rester fidèle à la vendange et au terroir.
Elevage :
Les étapes de la vinification passées, il faut élever le vin pour le civiliser un peu avant de le mettre en bouteilles. Le vin peut ainsi séjourner de quelques semaines à quelques années dans des barriques, demi-muids ou foudres en bois, cuves inox ou béton, œufs en béton, amphores de grès ou de terre cuite, etc. De par leur taille, leur forme et leur matériau, tous ces contenants peuvent avoir une influence sur le vin, relativement neutre ou beaucoup plus marquée, au bon gré du vigneron. Et ce dernier n’a pas assez d’une vie entière pour tout essayer ! Durant l’élevage, certains touchent un peu au vin pour leur donner par exemple plus de gras en remettant les lies en suspension dans la barrique, quand d’autres les laissent tranquilles. Pour une cuvée composée de vins issus de différents cépages ou de différentes parcelles vinifiés séparément, il faut aussi passer par la phase d’assemblage : après celle-ci, il y a nécessité à laisser le temps au vin de bien s’harmoniser. Avant la mise en bouteilles, le vigneron peut ensuite décider de clarifier son vin, donc d’éliminer d’éventuels risque de dépôt en bouteille et de favoriser la limpidité et la brillance du vin. La technique la plus utilisée pour ça : la filtration. Elle peut être douce ou plus sévère. Certains vignerons ne pratiquent pas la filtration, pour éviter de dépouiller les vins et de leur faire perdre un peu de profondeur.
Le vin jugé prêt par le vigneron est ensuite mis en bouteilles. Avant de le commercialiser, certains domaines le gardent encore un peu histoire de prolonger l’élevage par un petit affinage en bouteille.